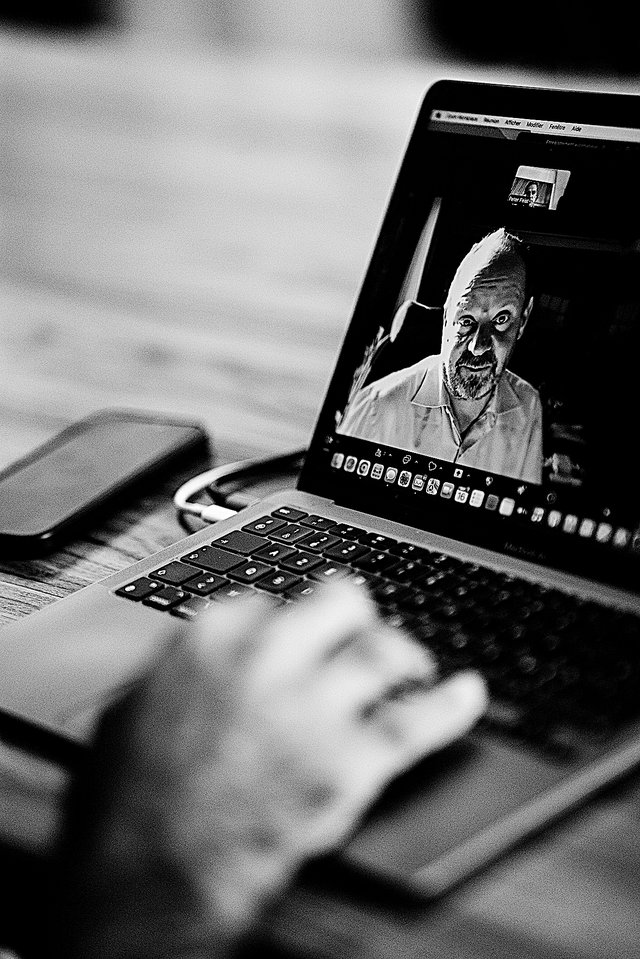D’Land : Professeur Sands, le point de départ de votre dernier ouvrage, 38 Rue de Londres, c’est l’arrestation du dictateur chilien Augusto Pinochet à Londres, en 1998. En quoi était-ce un événement historique ?
Philippe Sands : C’est la première fois dans l’histoire des êtres humains qu’un ancien chef d’État se fait arrêter dans un autre pays pour un crime international. L’histoire aborde la question de l’immunité et de l’impunité. Elle dessine aussi les relations entre Pinochet et un ancien nazi qui s’est réfugié en Argentine, Walther Rauff. L’impunité, c’est le cœur battant de cette histoire. C’est un cœur battant en ces temps qui courent aussi. L’après-midi du 16 octobre 1998, une demande d’arrestation signée par le juge espagnol Baltasar Garzón est arrivée à Londres. Le Royaume-Uni avait l’obligation de l’arrêter en vertu de la convention européenne sur l’extradition liant le Royaume-Uni et l’Espagne.
Si Benyamin Netanyahu atterrissait à Londres demain, que se passerait-il ?
En ce qui concerne Monsieur Netanyahu, Monsieur Poutine, Monsieur Duterte (Rodrigo, ancien président des Philippines arrêté en mars cette année pour crimes contre l’humanité, ndlr), des individus inculpés par la Cour pénale internationale (CPI), il y a aussi une convention internationale. En principe, si Monsieur Poutine ou Monsieur Netanyahu débarquent à Londres, le Royaume-Uni a une obligation conventionnelle, sur la base du statut de la CPI, de les arrêter. Mais il y a une question plus complexe : Est-ce qu’un président ou un Premier ministre en place ont droit à l’immunité ? Pinochet était un ancien chef d’État. Dans ce cas, je pense que c’était plus clair. Pour un chef d’État en place, il y a de nouvelles questions. En plus, ni la Russie ni Israël ne sont parties au statut de Rome instituant la CPI. Dans ce contexte, il faut se poser la question des relations entre un pays tiers et le statut de la CPI : est-ce que la CPI peut enlever une immunité qui subsiste sur la base du droit international ? On n’a pas la réponse à cette question.
Il n’y a pas encore de jurisprudence ?
Non. Les juges de la CPI ont dit « oui, ces gens-là n’ont pas d’immunité », mais demeure la question de savoir si cette décision est correcte et si elle peut s’appliquer à des pays tiers qui ne sont pas membres de la CPI. Pinochet a perdu en mars 1999 son immunité suite à une convention contre la torture adoptée en 1984. Il a perdu son immunité au moment où cette convention est entrée en vigueur pour le Chili, l’Espagne et le Royaume-Uni, c’est-à-dire en décembre 1988. Les juges de la Chambre des Lords ont statué. Tout État partie à la Convention contre la torture était obligé d’arrêter et d’inculper toute personne qui a pratiqué un acte de torture ou de l’extrader envers un pays tiers. Ce traité implique donc qu’il n’y a pas d’immunité, même pour un ancien chef d’État. Et ça ne s’applique pas de la même façon quand on a un ancien chef d’État ou le chef en exercice d’un pays qui n’est pas membre de la convention en vigueur. Ça, c’est la grande question. S’il arrive à Londres, la Cour pénale dit : « Il faut l’arrêter ». La Russie et Israël disent : « Nous avons droit à l’immunité en droit international ».
En 1998, quand Pinochet est arrêté, c’est un peu l’âge d’or de la justice internationale…
Absolument. En juillet 1998, a été adopté le statut de Rome instituant la CPI (mise sur pied en juillet 2002, ndlr). Octobre, arrestation d’Augusto Pinochet. Mai 1999, inculpation de Slobodan Milošević (alors président de la Serbie, puis incarcération en 2001, ndlr).
Vous avez travaillé à l’élaboration du statut de Rome. Quel était votre rôle ?
J’ai rédigé le préambule avec la délégation des Îles Salomon et Andrew Clapham, un collègue britannique qui travaille à l’Institut des hautes études à Genève. Nous avons introduit une ligne qui dit que tout État a une obligation d’arrêter toute personne ayant commis un crime international qui se trouve sur son territoire («Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux »). Ils ont pensé que les grands États allaient enlever tout ça, mais ils ne l’ont jamais fait.
L’idée du statut de Rome, instituant la CPI, était donc de créer une juridiction permanente qui ressemblait à Nuremberg, qui jugeait les crimes de masse, n’est-ce pas ?
Tout à fait. Les États ont mis cinquante ans à négocier cela, mais l’idée était de créer une cour pénale permanente.
Diriez-vous qu’en 2024-2025, la justice internationale vit des heures sombres, avec ce statut de Rome qui n’est pas ratifié par les États-Unis, et Donald Trump qui sanctionne les équipes de la CPI ?
Il est clair que la CPI vit un moment très difficile. Le droit international, en général, vit un moment très difficile. Mais on peut aussi souligner que c’est une année durant laquelle nous avons créé le premier tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine. L’accord entre les 35 pays a été scellé en mai à Lviv (ville ukrainienne depuis laquelle le grand-père de Philippe Sands a fui devant les nazis et où ont étudié Raphael Lemkin, inventeur du concept de génocide, et Hersch Lauterpacht, qui a pensé le principe de crime contre l’humanité, deux juristes internationaux mis à l’honneur dans East-West Street — Retour a Lemberg — de Philippe Sands, lui-même initiateur dès le 28 février 2022 de l’idée d’un nouveau tribunal visant le crime d’agression, absent des statuts de la CPI, ndlr). Nous voyons donc des tendances un peu contradictoires. On fait un pas en avant, deux pas en arrière. Un grand débat sur l’avenir du droit international est mené. Mais le droit est là.
Mi-août, vous avez accordé un entretien fleuve à Ezra Klein. Le journaliste du New York Times y recense les atrocités commises par le gouvernement de Benyamin Netanyahu dans la bande de Gaza. Vous en prenez note, mais vous ne voulez pas parler de génocide en cours. Pourquoi ?
À Gaza, comme pour les événements du 7 octobre, il y a des crimes. Ils peuvent être caractérisés comme crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocide. Les juges vont statuer sur la qualification. Des procès sont en cours. L’Afrique du Sud a intenté un procès contre Israël (pour génocide, ndlr). Un autre avait commencé un peu avant cela, la Gambie contre la Birmanie (Myanmar, sur le massacre des Rohingyas, ndlr). Je suis impliqué. Et parce que je suis impliqué, j’évite de m’exprimer sur telle ou telle situation, que cela soit l’Ukraine, Gaza, la Birmanie ou le Soudan, où il y aurait, oui ou non, un génocide. Une des raisons à cela est que l’interprétation et l’application des conventions sont contestées. On n’a pas de jugement de la Cour internationale de justice (CIJ) depuis 2015 et l’affaire de la Croatie contre la Serbie. J’étais conseil pour la Croatie. La Cour a dit qu’il n’y avait pas de génocide. Elle a pris une définition très particulière mettant la barre assez haut pour établir un acte de génocide. Le procès dans l’affaire Birmanie ouvre au mois de janvier. Nous verrons quelle direction vont prendre les juges. C’est pour cela que j’ai dit à Ezra Klein, qu’il y a une distinction entre la définition juridique du génocide et la définition appliquée par la plupart des gens qui sont intelligents, lisent et réfléchissent. Ce fossé entre ces définitions crée des problèmes.
Est-ce que, comme on peut l’entendre, seule une cour est habilitée à qualifier une situation de génocide ?
Non. Si les gens veulent dire maintenant que telle ou telle situation est un génocide, absolument, ils ont le droit. Mais moi, pour des motifs déontologiques, en tant qu’avocat plaidant dans ce type de procédure, je ne dessine pas de perspective sur les qualifications juridiques. Et non, il y a un rapport aujourd’hui de la High Commission for Human Rights (des Nations unies, ndlr) qui va très loin. La commission est indépendante. Ce sont des gens sérieux. Leur rapport (concluant à un génocide à Gaza, ndlr) est important. Ils ont absolument le droit d’arriver à leur conclusion et on verra prochainement si les juges sont d’accord ou non.
Ce n’est pas seulement une question d’ampleur du crime, il faut une intention de détruire ou tout partie d’un groupe. En 2001, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie avait reconnu le génocide de Srebrenica à l’issue du premier procès Krstic, militaire condamné pour avoir mené l’exécution de près de 8 000 Musulmans piégés dans une nasse refermée qui fait un peu penser au sort des habitants de Gaza…
On va voir ce que les juges vont décider, mais un aspect qui, pour moi, universitaire et praticien, est très important, c’est qu’il n’existe pas, en droit, de hiérarchie entre crime de guerre, crime contre l’humanité ou génocide. Dans le grand public, c’est clair qu’il existe une hiérarchie. Pour la plupart des gens, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité est beaucoup moins sérieux qu’un génocide. Est-ce que l’assassinat de 8 000 Bosniaques à Srebrenica est pire que la tuerie de plusieurs millions de Congolais à peu près au même moment ? Bien sûr que non. Ce sont des atrocités qui doivent cesser.
Dans Retour à Lemberg, premier ouvrage de votre trilogie historico-juridique, vous semblez plus proche de Lauterpacht (théoricien du droit désireux de protéger l’individu via le crime contre l’humanité) que de Lemkin (théoricien d’un droit protégeant un groupe via le génocide) …
C’est correct. Mais je conclus en embrassant Lemkin à la dernière page du livre. Je comprends Lemkin. Je comprends ce qu’il voulait.
Parce qu’il est plus humain ?
Parce qu’on est tous membres de tel ou tel groupe. Et être membre d’un groupe répond à un instinct fort chez l’être humain. L’idée d’une tuerie qui vise un groupe en particulier, cela suscite, je pense, une émotion qui est différente, pas nécessairement pire, mais différente qu’une tuerie qui ne vise pas une identité collective.
Dans 38, rue de Londres, est-ce qu’on retrouve cette même tension entre les deux pensées juridiques ?
Cette affaire Pinochet, au Royaume-Uni et en Espagne, a commencé comme une affaire de génocide et de crime contre l’humanité. Le général Franco avait intégré le crime de génocide dans le droit espagnol au début des années 1970. Le juge Baltasar Garzón a procédé sur la base de génocide et crime contre l’humanité. Et finalement, les tribunaux britanniques ont statué sur la torture qui est un crime contre l’humanité et pas un crime de génocide.
Est-ce qu’il Il y avait une notion de groupe dans ce raisonnement juridique, un groupe en tant qu’opposant politique ?
C’étaient des groupes politiques. Dans la Convention de 1948, les groupes politiques ou les groupes sociaux ne comptent pas. Dans l’application de la Convention de 1948 dans le droit espagnol entre 1971 et 1983, ils ont pris une définition qui contenait, parmi les groupes, les groupes politiques et les groupes sociaux. Sur cette base, les juges ont pu avancer sur le génocide.
Est-ce qu’il a été retenu dans une autre affaire devant une juridiction internationale que le groupe victime de génocide n’était pas ethnique ou religieux ?
Non. Dans toutes les procédures devant les tribunaux internationaux, Yougoslavie, Rwanda, CPI, le groupe, c’est ethnique, national ou religieux. Ce n’est pas social ou politique. Le Brésil a été le premier pays à inclure dans sa propre définition de génocide une identité sexuelle, mais cela n’existe pas encore en droit international.
Dans Retour à Lemberg, vous évoquez l’implication de Lemkin dans l’élaboration de la Convention sur le génocide en 1948. Est-ce qu’un État peut se rendre coupable de manquement à la prévention du génocide, couverte par le texte, en aidant indirectement un État potentiellement coupable de crime de génocide. Je pense par exemple au Luxembourg qui permet la commercialisation des obligations israéliennes finançant, au moins en partie, la guerre du gouvernement Netanyahu.
En droit international, la notion de complicité est bien établie, mais il faut avoir un lien direct. Au moins plus direct qu’indirect. Je ne connais pas les faits dont vous parlez, donc je ne dessine aucune perspective. Mais un procureur, dans cette situation, doit se poser la question de savoir s’il y a un lien direct ou indirect. Et si c’est indirect, est-ce que c’est assez central pour qu’on puisse dire qu’il y a une complicité ? Ce sont des questions de faits et de droit. C’est très complexe.
Un article paru récemment dans le Guardian revient sur l’ambivalence de Keir Starmer, ancien juriste en droit international de renom (qui a d’ailleurs plaidé avec vous pour la Croatie contre la Serbie) qui peine à défendre les droits humains comme avant, maintenant qu’il est Premier ministre du Royaume-Uni. Comment l’expliquez-vous ?
C’est un homme politique maintenant. Il est soumis à des forces différentes. Mais en général, ce gouvernement britannique a pris une approche qui est beaucoup plus pro droit international que les gouvernements précédents. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui disent qu’il ne va pas assez loin. Mais, par exemple, le gouvernement précédent de Rishi Sunak était intervenu devant la CPI pour dire qu’elle n’avait pas compétence sur les crimes commis en Palestine, ceux qui avaient été identifiés comme perpétrés par les forces armées d’Israël. Le gouvernement de Starmer a fermé cette procédure.
Vous représentiez la Palestine dans l’affaire sur l’occupation israélienne devant la Cour internationale de justice, et qui a mené en juillet 2024 à une décision de première importance. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui a été obtenu ?
J’ai été conseil de la Palestine jusqu’à mi-2024, quand la CIJ a remis son avis consultatif. Il s’agissait d’un procès sur l’autodétermination qui a lui-même suivi une décision de la CIJ de 2019 dans une autre affaire où j’étais très impliqué pour l’Île Maurice, contre le Royaume-Uni (affaire des Îles Chagos, ndlr). La CIJ avait alors décidé que le Royaume-Uni était en occupation illégale d’une partie du territoire de l’Île Maurice. Et, maintenant, c’est plutôt positif pour le droit international : Au mois de mai, le traité entre l’Île Maurice et le Royaume-Uni a été signé. On espère qu’il va prochainement entrer en vigueur pour que les Britanniques réparent cette illégalité. Sur cette base, l’autorité palestinienne a tenté une procédure similaire et la CIJ a adopté une décision assez similaire. Les Palestiniens ont droit à l’autodétermination. Israël doit respecter ce droit. Comme tout autre pays.
Et rendre les territoires occupés…
Oui, restituer les territoires. Absolument. C’est une décision qui va assez loin.
L’élan vers la reconnaissance de la Palestine a repris concomitamment en Europe occidentale. Un certain nombre d’États dont le Luxembourg, le Royaume-Uni et la France devraient franchir le pas dans une conférence sur la solution à deux États organisée à New York dans les prochains jours. Est-ce-que cette vague de reconnaissance, ajoutée à plus de 140 pays qui ont déjà reconnu la souveraineté palestinienne, va davantage protéger les Palestiniens en droit ?
C’est avant tout politique et symbolique, mais il y a des conséquences juridiques. Cela met les deux États sur un pied d’égalité. Sans reconnaissance, il n’y a pas d’égalité. Théoriquement, cela a des conséquences. C’est la raison pour laquelle, je suppose, le présent gouvernement d’Israël s’oppose fermement à cette reconnaissance.
Vous êtes également passé par Luxembourg pour plaider devant le Tribunal européen, en 1995, pour Greenpeace contre la Commission afin de bloquer la construction de centrales électriques aux Canaries. Une affaire révélatrice de votre engagement pour l’environnement. Vous travaillez également sur la reconnaissance de l’écocide…
C’est un grand projet. Le but est de créer le cinquième crime international. Les quatre autres sont l’agression, le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le génocide, tous fondés sur la protection de l’être humain. L’écocide ouvre une nouvelle porte pour protéger l’environnement. Cette porte s’est ouverte en décembre dernier avec une demande de plusieurs États d’inscrire dans le projet de travail de la CPI un projet d’amendement éventuel du statut. C’est en route. Cela va prendre du temps, mais cela aboutira. Les jeunes générations sont très accrochées à ce développement. Je viens de donner la grande conférence de rentrée à Sciences-Po Paris et la moitié des questions portaient sur l’environnement.
Un signe positif pour la justice internationale ?
C’est un projet à long terme. Nous vivons un moment difficile. Certains disent que nous sommes entrés dans un monde post rules. Je ne suis pas d’accord. La plupart des règles marchent très bien. Je prends un train ce mercredi pour La Haye. L’acheminement se base sur une vingtaine de conventions, de traités en droit international. Cela marche très bien. Dans le domaine de la guerre et des droits de l’Homme, il y a un problème. Comment est-ce qu’on va s’en sortir ? Cela prendra du temps. Quand j’étais jeune chercheur à l’Université de Cambridge en 1980, un collègue, grand professeur d’histoire du droit, me demandait parfois durant le déjeuner sur quoi je travaillais. J’expliquais et il disait : « Oui, je comprends. On avait un problème comme ça en droit anglais en 1472 et on a mis 275 ans à s’en sortir. » La justice internationale est née en 1945. Nous sommes à peine entrés dans l’ère moderne. À long terme, je suis plutôt optimiste.
C’est un peu le message de votre trilogie*…
J’ai écrit cette trilogie pour toucher le grand public et expliquer ce qui a été obtenu en 1945. C’est une réflexion sur des principes et des valeurs qu’il faut défendre. J’ai compris au moment de la guerre en Irak que parler avec les juristes en droit international ne suffisait pas. Il fallait toucher un grand public. Ces livres sont maintenant traduits en une trentaine de langues. Quelle surprise, quel bonheur !
Histoire en écritures
Au carrefour de l’histoire, Philippe Sands (né le 17 octobre 1960 à Londres) sort la boussole du droit international. Le franco-britannique l’enseigne dans des universités de référence, notamment à l’University College London où il est titularisé depuis 2002. Il avait défendu sa thèse de doctorat à Cambridge (1983). Il officie également en tant qu’avocat au sein du cabinet Matrix Chambers. Son parcours d’internationaliste l’a mené devant toutes les juridictions internationales. Son nom apparaît dans des affaires clés. Il en a récolté des honneurs, comme le titre de Queen’s Counsel (dorénavant King’s Counsel). Chercheur en droit, il a évidemment alimenté la doctrine et créé de nouveaux principes, à l’instar des protagonistes de son ouvrage phare. Philippe Sands a acquis une renommée dans le grand public en 2016 avec la parution de East-West Street : On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity (Retour à Lemberg, pour l’édition française). Dans ce passionnant thriller judiciaire (passant par le Luxembourg et Mondorf où étaient détenus les accusés de Nuremberg en 1945), Philippe Sands place Lviv (aujourd’hui en Ukraine) comme le point de départ de son histoire de la Shoah, une histoire à la fois personnelle et collective. Personnelle car c’est celle de son grand père, Leon Buchholz, résident de Lviv contraint à l’exil devant les nazis, mais dont une grande partie de la famille en sera aussi victime. À l’instar des familles de Hersch Lauterpacht et Raphaël Lemkin, qui ont eux essuyé les bancs de l’Université de Lviv avant de servir le droit international et l’intérêt collectif. Le premier en faisant condamner les responsables nazis pour crime contre l’humanité lors du procès de Nuremberg et le deuxième en œuvrant pour la Convention contre le génocide de 1948, deux crimes internationaux. Le petit-fils de Leon Buchholz œuvrera a en faire reconnaître deux autres.